“Peut-on imaginer plus démoralisant qu’une vie où l’on se réveille cinq jours sur sept pour aller accomplir une tâche dont on estime secrètement qu’elle n’a aucune raison d’être, qu’elle n’est qu’un gaspillage de temps et de ressources, voire qu’elle est nuisible ?”
Pas pour l’anthropologue militant David Graeber.
Été 2013, le chercheur américain publie pour le magazine Strike! et sur la base d’une intuition un article baptisé “Le phénomène des jobs à la con” (“bullshit jobs”). Comprendre : ces boulots qui ne paraissent pas consister en grand-chose et sont si profondément inutiles que “leur titulaire peut s’évaporer sans que personne ne s’en rende compte.” L’écho rencontré à l’international est immédiat, stimulé par la publication d’un sondage (YouGov) qui confirme l’hypothèse : 37% des Britanniques sondés affirment que leur boulot ne sert à rien… David Graeber décide alors de creuser le sujet dans “Bullshit Jobs : A Theory”, (Penguin., 2018) et s’interroge : pourquoi ces “bullshit jobs” sont-ils si néfastes pour notre santé mentale ? Et comment s’y soustraire ?
1. Comment reconnaître un bullshit job ?
Au fil des témoignages, l’anthropologue affine sa définition du “bullshit job” : “une forme d’emploi si totalement inutile, superflue, ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence, bien qu’il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu’il n’en est rien.”
Pour l’auteur, la perception subjective du salarié reflète bien la réalité. À ses yeux,“il existe bien une valeur sociale distincte de la pure valeur de marché”, et (presque) tous les individus seraient capables de la faire. Autrement dit : si vous avez le sentiment que votre boulot ne sert à rien, c’est probablement le cas…
Pour y voir plus clair, David Graeber propose une typologie des “métiers à la con” :
- Les larbins, dont la fonction est de faire paraître quelqu’un d’autre important : portiers, démarcheurs téléphoniques pour le compte d’un courtier, certains assistants administratifs…
- Les porte-flingues, dont le métier comporte une dimension agressive et sont néfastes en plus d’être superflus : lobbyistes, avocats, conseillers fiscaux, experts en relation publique…
- Les rafistoleurs, qui réparent les anomalies enrayant une organisation (anomalies qui pourraient être corrigées en amont) et camouflent les incompétences de leurs supérieurs : chasseurs de bug…
- Les cocheurs de case, qui permettent à une entreprise de prétendre faire autre chose que ce qu’elle fait réellement et donnent lieu à “d’interminables séries de rituels” : consultants en tout genre…
- Les petits chefs, qui assignent des tâches ou les génèrent dans le but de les confier à d’autres : superviseurs, management intermédiaire…
Précision importante : David Graeber oppose les métiers “à la con” (“bullshit jobs”), principalement des emplois salariés de cols blancs (“auréolés d’honneur et de prestige”), aux “jobs de merde”, bien souvent des emplois payés à l’heure de cols bleus, pourtant indispensables au bon fonctionnement de la société, mais mal payés et socialement mal considérés (éboueurs, instituteurs, infirmiers…) En outre, et contrairement aux idées reçues, le phénomène concernerait tout aussi bien le secteur public que privé (“la privatisation génère son propre lot de folie”), à une différence près toutefois : au sein du privé, la surveillance exercée serait bien plus étroite.
Le plus sidérant pour l’auteur est l’étonnante prolifération de ce type d’emplois, qui loin de mourir de leur belle mort, expurgés par la loi du marché, prennent de plus en plus de place dans le monde du travail. “C’est comme si quelqu’un s’amusait à inventer des emplois inutiles dans le seul but de nous garder occupés ”, s’amuse l’anthropologue.
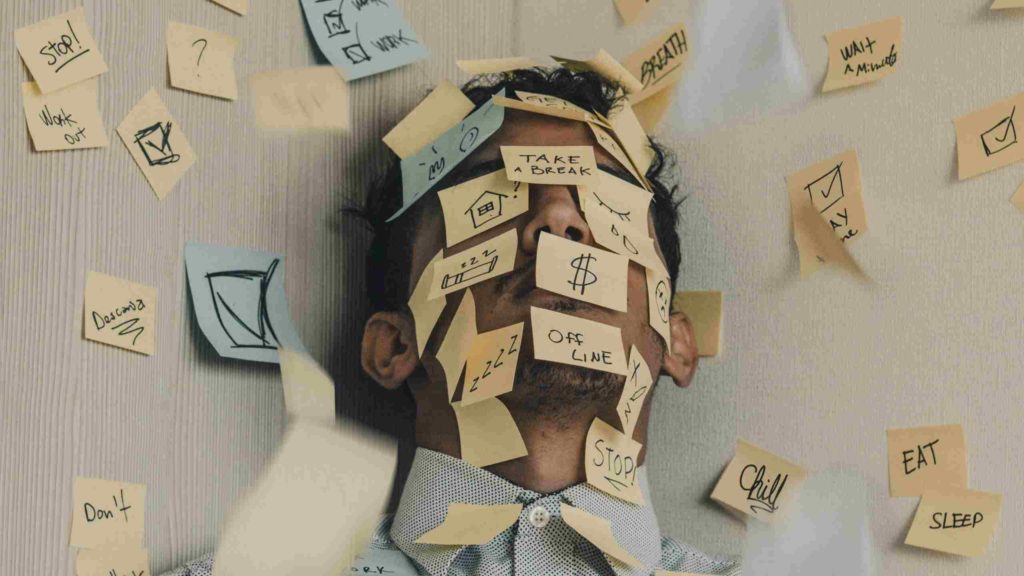
2. Bullshit jobs : causes et effets secondaires
Et les conséquences sont désastreuses pour la santé mentale des travailleurs, transformés malgré eux“en parasites ou imposteurs”.
Entre absence de stimulation intellectuelle et isolation, aliénation et impression écrasante de vacuité, dépression et brown-out (“Si je n’ai jamais de défis à relever, comment savoir je suis compétente?” s’interroge Lilian, chef de projet produits numériques), effondrement psychologique et sensation d’être exproprié de son temps (“Un tel niveau d’ennui est difficilement concevable. Cela confine à la transe” rapporte Nigel, travailleur intérimaire), tous les sondés s’accordent sur une formule : “cauchemar kafkaïen”… Pour eux, le pire réside dans l’obligation d’avoir à se mettre en scène, de donner l’impression d’être occupé et heureux de son sort tout en se débattant dans une situation de simulacre insoutenable. Car pointer du doigt l’absurdité de la situation reviendrait à exposer la supercherie ; et peut-être à perdre son emploi dans la foulée…
“C’est une expérience insupportable et accablante. (…) Comment parler de dignité au travail si l’on estime en son for intérieur que son job ne devrait pas exister ? Comment s’étonner que cela engendre de la rage et de l’aigreur?” Cette souffrance provient du fait que les “bullshit jobs” nous privent de la joie que nous procure le fait d’influer de manière prévisible sur notre environnement, ou comme le formule le psychologue allemand Karl Goos en 1901, “la joie d’être cause.” Cette privation, contraire à l’essence même de liberté, provoquerait un douloureux éclatement du moi.
La situation a de prime abord de quoi étonner. En effet, dans notre monde compétitif où le marché agit supposément comme régulateur, des agents rationnels devraient a priori toujours agir en vue d’une allocation optimale des ressources. Or, la multiplication des “bullshit jobs” suppose le contraire.
Pour appréhender cette anomalie, Mark Graber analyse la manière dont est perçu le travail. En Grèce et Rome antiques, l’effort physique et la servitude étaient par exemple réservés aux femmes et aux esclaves, puisqu’ils avilissent et accaparent le temps qui devrait être dévoué aux obligations sociales et politiques.
A contrario, sous l’influence conjuguée du christianisme du capitalisme, le travail est aujourd’hui perçu comme une vertu en soi, comme quelque chose de nécessaire et salvateur, presque purificateur : “En vertu d’une curieuse logique sadomasochiste, nous estimons que la souffrance au travail est la seule justification légitime des plaisirs consuméristes que nous nous octroyons furtivement.” Alors que notre rapport au temps s’inscrit dans une logique de moralité, le perdre est devenu immoral, l’oisiveté délétère : “Nous sommes devenus une civilisation fondée sur le travail (…), le travail comme fin et sens en soi.” Refaire le monde en sirotant des lattes avec ses amis prend du temps, contrairement au fait de commander un Deliveroo ou de s’acheter en ligne des lunettes de soleil, deux activités qui “s’insèrent parfaitement dans les petites plages de libertés prévisibles au cours d’une journée de travail.”

3. Comment se soustraire aux “jobs à la con”
Capitalisme et “bullshit jobs”, les deux sont pour David Graeber inextricablement liés. “C’est une situation désastreuse, et il faut qu’elle prenne fin.”
Situation d’autant plus désastreuse qu’elle serait évitable. Dès 1930, l’économiste J.M Keynes prédisait que les technologies auraient suffisamment progressé d’ici la fin du siècle pour que la Grande-Bretagne puisse instaurer une semaine de travail de quinze heures. “Au contraire, la technologie a été mobilisée pour nous faire travailler plus.” Et au lieu de “vaquer à nos occupations”, nous avons préféré gonfler l’administration jusqu’à l’overdose. “Par l’effet d’une étrange alchimie que personne ne comprend tout à fait, le nombre de gratte-papier semble gonfler. (…) Comme l’a bien noté Orwell, une population occupée, même à des tâches complètement inutiles n’a guère de temps pour quoi que ce soit d’autre.”
Si l’auteur répugne à émettre des recommandations, il propose toutefois une piste pour mettre un terme aux “bullshit jobs” : la réduction du temps de travail par le revenu universel, qui constituerait une première étape clé pour désolidariser totalement le travail de la subsistance.
À cette conclusion que certains pourraient considérer extrême, Hien-Thuan Quach, Coach Agile chez Wemanity tient à opposer un point de vue plus nuancé : “Je préfère parler de bullshit task ou bullshit activity, avec cette idée que les jobs sont composés d’activités, certaines utiles d’autres beaucoup moins.”
Si à titre personnel Hien-Thuan Quach ne reconnaît absolument pas son emploi dans la dénomination “bullshit job”, il propose d’aborder la question comme le conseillait Albert Einstein (« Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avions quand nous les avons créés »), c’est-à-dire en essayant de prendre du recul et de s’extraire des paradigmes qui nous enferme.
Concrètement, le coach agile recommande de :
- Se demander s’il est possible d’agir sur la tâche qui pose problème
- Si oui, questionner jusqu’à identifier les bons leviers pour modifier la tâche
- Si non, terminer la tâche en y consacrant le minimum de temps et d’énergie
“Qu’il s’agisse d’une tâche ou d’un job, j’ai l’impression qu’il existe toujours la possibilité de faire quelque chose soit pour modifier le job ou la tâche directement, soit pour limiter l’impact qu’elle a sur nous”, affirme Hien-Thuan.
Et pour les adeptes des solutions plus radicales, qu’ils se rassurent. Loin des dangers que certains prédisent, seuls très peu de gens choisiraient selon l’auteur de rester totalement oisifs en cas d’instauration d’un revenu universel. Non, nos villes ne seraient pas envahies de “mimes de rues soporifiques” et « d’hurluberlus versés dans des théories scientifiques fumeuses”. Pour l’anthropologue, l’écrasante majorité des gens souhaitent se consacrer à quelque chose qui compte. Ce n’est pas une coïncidence s’il a dédié son livre “à tous ceux qui préféreraient être utiles à quelque chose.”












